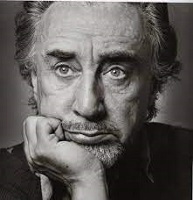Les Antimémoires
Les Antimémoires
entre autobiographie et autofiction
Moncef KHEMIRI
Faculté des Lettres de la Manouba, Tunis
Version PDF : Khemiri_antimemoires
La notion d’«autofiction» est associée de nos jours au nom de Serge Doubrovsky qui en avait lancé l’idée en 1977 sur la quatrième de couverture de son roman Fils1.
Cette notion est venue alors révolutionner l’idée que l’on s’est faite de l’autobiographie, à la suite des premiers travaux de Philippe Lejeune. Celui-ci, dans sa célèbre définition de l’autobiographie – «récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité»2 – avait surtout pris en considération la dimension référentielle de l’œuvre autobiographique et sa prétention à la vérité : «Si l’autobiographie est une entreprise de quelque portée, elle doit se fonder sur une visée de la vérité, chez l’auteur, et sur une confiance dans la sincérité de l’auteur, chez le lecteur»3, explique Jacques Lecarme.
Pour Doubrovsky, au contraire, ce qui prime dans le récit autobiographique, c’est moins le principe du réel que celui de l’imaginaire, car dès que l’on parle de soi – à la première ou à la troisième personne, peu importe – et surtout lorsqu’on écrit sur soi, l’on se retrouve immanquablement dans la position du romancier inventant un personnage : «Le récit le plus véridique ne peut s’empêcher d’être roman, si j’écris sur moi, j’en deviens fictif […] pour demeurer en mémoire, je suis devenu mon propre mémorialiste, je récupère tout ce que je peux rattraper, je ramasse toutes mes miettes, de livre en livre j’ai refabriqué ma vie, j’en ai fait de vrais romans qui sont aussi des romans vrais, marque de fabrique, j’ai appelé ce produit l’autofiction, le mot d’abord rejeté, à présent on l’adopte, il désigne au-delà de mes écrits toute une série d’œuvres de ce temps, l’entreprise autofictive prospère […]», écrit-il dans Laissé pour conte.
Nous voudrions, dans cette étude, relire, à la lumière de cette notion d’«autofiction», les Antimémoires (1967) d’André Malraux qui nous paraissent, considérés sous cet angle, d’une incroyable modernité. Publiés en 1967, les Antimémoires, semblent annoncer ce qui se joue d’essentiel dans l’écriture autobiographique moderne dans la mesure où tout en se donnant à lire comme un récit autobiographique traditionnel, ils subvertissent le pacte autobiographique en intégrant à des faits réels avérés4 des éléments soit fictifs, soit fictionnels. «L’anti-biographie» de Malraux, selon l’appellation que lui donne Edson Rosa da Silva5 – rejoindrait ainsi la pratique de l’autofiction6 moderne. Rappelons qu’en 1995, Jacques Lecarme dans un article paru dans la Revue des Lettres modernes, avait pas hésité à attribuer à Malraux la paternité de «l’autofiction », du moins comme pratique, entre autres à Malraux : «De cette autofiction, Malraux nous semble l’un des inventeurs, bien que ce mérite ne lui soit pas reconnu »7. Une étude des Antimémoires sous l’angle de l’autofiction s’impose d’autant plu que cet ouvrage est encore mal compris par beaucoup de critiques qui mettent certaine distorsions de la réalité historique ou biographique sur le compte de la propension de l’auteur «aux embellissements pathétiques», voire à la mythomanie. En effet, en 2001, alors que l’on célébrait un peu partout en France et dans le monde le centenaire de la naissance d’André Malraux, Olivier Todd fit paraître chez Gallimard une monumentale biographie de Malraux 8 Le biographe, sous prétexte de rétablir la vérité concernant certains épisodes de la vie de Malraux tant pendant la guerre d’Espagne qu’à l’époque de la Résistance, a présenté l’auteur des Antimémoires comme un «myhomane», soucieux avant tout de son «auto-promotion.» Et c’est à l’oeuvre autobiographiqu qu’André Malraux avait commencé à écrire, en 1965, sur le paquebot le Cambodge qui le conduisait en Chine et qui a été le grand événement littéraire, à sa parution en 1967, que Todd a réserve ses jugements les plus acerbes. Parlant de Malraux autobiographe, il écrit : «Il casse la chronologie, construit des chapitres avec des pages de livres précédents recasées ou recyclés. Ceux qui sont hostiles à l’ancien, au nouveau Malraux ou aux deux, penseront que son inspiration et son imagination faiblissent […]. Partout dans ses Antimémoires, il mêle l’apparence, l’éphémère des histoires à l’Histoire; la vérité romanesque et le roman de ses vérités qui mentent avec la même logique implicite : ce qui aurait dû être a été » 9. Cette biographie qui ressemble davantage à un pamphlet, révèle, à notre sens, une grave incompréhension des enjeux véritables de l’entreprise autobiographique malrucienne.
En dépit de ses insuffisances, la biographie de Todd a eu le mérite, comme le note avec raison Henri Godard, de susciter un regain d’intérêt pour l’œuvre autobiographique de Malraux : «La publication récente d’une biographie de Malraux qui se veut à l’anglo-saxonne, au plus près des faits, mais ne cesse de porter un jugement négatif, directement ou indirectement, redonne de l’actualité à une question qui se pose depuis la publication de la première partie du Miroir des limbes, les Antimémoires, en 1967 : dans quelle mesure la valeur de l’œuvre dépend-elle d’abord et avant tout, comme c’est le cas dans le genre littéraire des Mémoires, de la vérité des faits rapportés ? »10 Pour lui, le procès fait à Malraux sur la base du défaut de véracité et d’exactitude n’a de pertinence «qu’autant que l’on tient les Antimémoires pour des Mémoires et le «je» qui s’y exprime pour un je autobiographique », ce qui n’est pas évident dans la mesure où l’auteur s’est inscrit en faux aussi bien contre la tradition de l’autobiographie-confession, à la manière de saint Augustin ou de Rousseau, que contre celle des Mémoires à la manière de Saint-Simon ou du général de Gaulle. Le discours autobiographique de Malraux se situe ailleurs, nous semble-t-il, dans cette zone intermédiaire et que l’on appelle aujourd’hui l’autofiction et qui se caractérise par un discours bivalent, mi-enraciné dans la réalité référentielle et mi-tourné vers la fiction. En assemblant deux discours traditionnellement incompatibles, l’autofiction rend inopérante l’antithèse «vérité / fiction.» «L’opposition entre la réalité et la fiction sur laquelle se fonde le pacte autobiographique, se dilue ici »11, souligne Mounir Laouyen.
Nous voudrions pour éclairer les Antimémoires sous l’angle de l’autofiction, souligner d’abord la dimension nettement autobiographique de l’ouvrage. Bon nombre de faits qui y sont évoqués sont attestés ou vérifiables. Mais sur cette trame de faits réels, Malraux a greffé des fragments fictifs ou fictionnels qui entraînent le récit dans le domaine incertain de l’autofiction où se confondent réel et imaginaire. En effet, en dépit des protestations de l’auteur contre le genre autobiographique, les Antimémoires sont composés selon un canevas un canevas autobiographique certain.
1. Un canevas autobiographique
On a coutume, depuis les premiers travaux de Philippe Lejeune, de définir le genre autobiographique par le «le protocole nominal »12 de la triple identité, c’est-à-dire par l’usage d’une même identité nominale regroupant l’auteur, le narrateur et le protagoniste. Les Antimémoires se conforment à ce dispositif, mais d’une manière indirecte. Les informations sur le nom de l’auteur, sur ses parents, sur son nom de guerre, ne sont pas fournies spontanément comme dans de nombreuses autobiographies, mais elles sont présentées indirectement et parcimonieusement à l’occasion d’un interrogatoire policier. Capturé par les Allemands, après avoir été blessé dans une fusillade, le 22 juillet 1944, à l’entrée de Gramat, – la date et le lieu de l’arrestation figurent dans le texte13 et sont attestés par les biographes de l’auteur14, y compris Olivier Todd, – Malraux est interrogé par la Gestapo. A la faveur de cet interrogatoire, le lecteur apprend les noms et prénoms des parents de l’auteur, découvre que ce dernier s’appelle dans l’état civil Georges et non pas André et qu’il a un demi-frère qui s’appelle Roland, qui était entré tôt dans la Résistance, et avec lequel la police l’avait confondu : L’officier nazi lui dit :
– Vous prétendez que vous n’êtes pas le fils de Malraux Fernand et de Lamy Berthes, décédés ?
– Si.
– De quelle maladie est mort votre père ?
– Il s’est tué.
– Il feuilletait le dossier.
– Date ?
– 1930 ou 1931. Mais il n’y a pas d’erreur possible dans ma famille, lui seul s’est appelé Fernand.15
Si l’officier s’obstine à l’appeler Roland et lui donner trente-trois ans et non pas quarante-deux, c’est parce que Roland avait été aussi arrêté et que Paris s’était trompé de dossier et envoyé le dossier de ce dernier et non pas celui d’André qui, officiellement n’existe pas : «S’ils n’avaient pas trouvé mon dossier, c’est que j’oublie toujours que je ne m’appelle pas André. On ne m’a jamais appelé autrement. Pourtant à l’état civil, je m’appelle Georges.»16
Le lecteur y apprend aussi que le narrateur a fait la résistance sous le nom de Berger :
– Vous êtes bien Berger, n’est-ce pas ?
– Oui.
– Donc vous reconnaissez donc coupable.
– De votre point de vue, ça ne se discute.17
Enfin, il y découvre que l’auteur s’est évadé du camp de Sens où il était interné en 1940 pour rejoindre la zone libre. C’est d’ailleurs sur cette évasion que s’ouvrent les Antimémoires : «Je me suis évadé, en 1940, avec le futur aumônier de Vercors.»18
Quant à l’année 1965 qui est indiquée à la tête de la plupart des chapitres, elle correspond au temps de l’écriture de l’ouvrage. Atteint d’une profonde dépression, qui est sans doute la conséquence de la mort en 1961 de ses deux garçons, Vincent et Gauthier dans un accident de voiture, et du ressentiment qu’il en a éprouvé pour son épouse, Madeleine, leur belle-mère, à qu’il a reproché de ne pas avoir su les aimer, Malraux qui a 64 ans en 1965, entreprend, sur la recommandation des médecins et sur l’amicale invitation du général de Gaulle, un long voyage en Asie – avec une vague mission en Chine – destiné à l’aider à surmonter la cruelle dépression dans laquelle il se débat. «Je reprends, par ordre des médecins, cette lente pénétration, et regarde le bouleversement qui a empli ma vie sanglante et vaine, comme il a bouleversé l’Asie »19, écrit-il dans le prologue des Antimémoires. Les étapes de ce voyage forment en le fil conducteur de ce récit autobiographique. Il s’agit d’un voyage de près de deux mois (22 juin – 17 août 1965). Le 22 juin 1965, le paquebot Cambodge quitte Marseille pour Hong-kong. A son bord se trouvent en effet, André Malraux, Ministre d’Etat et Albert Beuret, directeur adjoint de son cabinet. Le 26 juin, Le Cambodge aborde à Port-Said, Malraux et Albert Beuret, son Directeur de cabinet, gagnent le Caire. Au pied de la Grande Pyramide, Malraux a une illumination : l’écrivain abandonne l’essai esthétique auquel il travaillait pour se consacrer à son nouveau projet: celui d’écrire une autobiographie. Le livre ressemblera alors à un journal de voyage : on voit l’auteur se retirer dans sa cabine pour écrire son nouveau livre. Le temps de l’écriture se confond avec le temps de la traversée. Le livre se développe au rythme des escales: 4 juillet, escale à Karachi; 6 juillet, arrêt à Bombay; 9 juillet, accident à Singapour où le Cambodge est éperonné par un pétrolier : «Je croyais qu’il n’avait plus de naufrages ?… A L’aube, une foudre horizontale fait frémir le Cambodge comme une boule billard dans un trou. Tout tombe. Le bateau ne s’arrête pas. Je vais à la fenêtre de la cabine. Un pétrolier, le nez écrasé, se retire du flanc de notre bateau.»20 Malraux et Beuret sont alors obligés de poursuivre leur voyage en avion: ils gagnent Hon-Kong par avion, et c’est par avion qu’ils vont de Pékin à Canton. Le retour en France s’effectue par l’Inde où ils séjournent du 8 au 12 août. Après une brève escale à Téhéran, Malraux et Beuret arrivent à Paris le 17 août. Le 18 août, le conseil des Ministres entendra le rapport du ministre d’Etat sur un voyage devenue «mission». C’est qu’au cours de son voyage, Malraux a rencontré le premier ministre de l’Inde Nehru et le Président Mao Tsé Toung.
Mais si circonscrit soit-il soit dans le temps, ce voyage a été aussi pour Malraux, l’occasion de revenir sur les grands épisodes de sa vie, dont la plupart sont étroitement liés à la découverte de l’Orient et de l’Extrême-Orient. Le voyage dans l’espace devient comme un voyage dans le temps. Les paysages et les réalités présentes de l’Asie réveillent, par métonymie, les souvenirs d’un temps révolu. Comme l’écrit l’auteur, revenir en Asie, en 1965, c’était comme «pénétrer avec lenteur dans le temps et l’espace conjugués.»21 C’est que l’Asie a été le champ de son expérience historique et le domaine où son imaginaire de romancier a pris corps. En 1924, alors qu’il n’avait que 23 ans, Malraux en compagnie de son épouse Clara s’enfonce dans les forêts du Siam, en Indochine, à la recherche des temples khmers de Banteaï-Srey. De cette aventure archéologique naîtra son roman La Voie royale. Une année après, devant les injustices commises à l’endroit des populations annamites par l’administration coloniale, il fonde à Pnom-Penh un journal libéral : L’Indochine enchaînée. En cette même année 1925, il se rend aussi à Hong-Kong, pour les besoins de son journal. Bien relativement court, ce séjour lui permet de comprendre les enjeux politiques de la lutte qui oppose les communistes aux nationalistes, et de réaliser qu’avec ces premières insurrections, la Chine était en train d’entrer dans l’Histoire. De cette découverte de l’action politique, il s’inspirera dans son roman Les Conquérants (1928). Le tour du monde qu’il effectue en 1931-32, lui permet de mieux approfondir sa connaissance de l’Asie et de la Chine en particulier et d’écrire le troisième titre de la trilogie asiatique : La Condition humaine (1933) qui est le roman de la révolution trahie. C’est à son oeuvre romanesque, et plus précisément aux Conquérants, premier volume de la trilogie asiatique, que songe alors Malraux dans les premières pages des Antimémoires : «Jusqu’à l’horizon, l’Océan glacé, laqué, sans sillage…» Je retrouve devant la mer la première phrase de mon premier roman, et sur la bateau, la cadre aux dépêches où l’on afficha, il y a quarante ans, celle qui annonçait le retour de l’Asie dans l’Histoire : “La grève générale est proclamée à Canton.”»22 L’escale au port d’Aden, au Yemen, réveille le souvenir de l’expédition aérienne que l’auteur a montée en 1934, avec son ami Corniglion-Molinier, pour retrouver la capitale de la Reine de Saba, en plein désert du Mareb. : «Depuis plus deux mille ans, cette terre, est une terre de légende. Elle le fut pour Rome, pour la Bible et pour le Coran, elle l’est pour les conteurs d’Ethiopie et pour la Perse.»23 Au retour de cette expédition, l’avion de l’auteur est pris dans un terrible ouragan. C’est cette expérience du danger et du «retour sur la terre» qui est d’après l’autobiographe le source d’un épisode important de son roman Le Temps du mépris, publié en 1934 : «C’est là que j’ai rencontré pour la première fois l’expérience du “retour sur la terre” qui a joué dans ma vie un grand rôle, et que j’ai plusieurs fois tenté de transmettre. Je l’ai transposée directement dans Le Temps du mépris.»24 L’autobiographe, quand il nous révèle des secrets, ils ont souvent trait, non pas à sa vie privée – Malraux méprise le «misérable petit tas de secrets »25 dont est faite tout vie d’homme – mais aux conditions de l’écriture de ses oeuvres romanesques.
D’autres souvenirs sont appelés par analogie. Ainsi quand Nehru dans une conversation avec l’auteur évoque ses prisons, Malraux songe à sa propre expérience de la captivité : «La liberté doit être cherchée entre les murs des prisons» avaient dit Gandhi et Nehru. Les miennes ne l’avaient pas été tout à fait, ou ne l’avaient pas été longtemps. Il y avait eu le camp de 1940 dont je m’étais évadé facilement […] / Il y avait plus sérieusement, 1944. Mes camarades, arrêtés par les polices allemandes, le plus souvent par la Gestapo, avaient suivi vers la mort, la filière que l’on connaît, alors que j’avais été pris, en uniforme, par les chars de la division Das Reich. / Mes prisons commencent dans un champ. Je revenais à moi dans une civière étendu sur l’herbe, que deux soldats allemands empoignaient.»26 Ce surgissement des souvenirs, par association d’idées, selon le double principe de la métonymie ou de l’analogie, explique pourquoi figurent en tête de chacun des chapitres qui forment cette œuvre deux dates : celle de 1965 y est souvent précédée d’une ou de deux autres dates antérieures. Pour le chapitre 3 par exemple, qui évoque l’expédition aéronautique au Yémen, nous lisons : «1934, Saba – 1965, Aden » Et pour le chapitre 6 où il est question de l’arrestation de l’auteur par les Allemands et le simulacre d’exécution dont il a été victime, se trouvent mentionnées encore deux dates, celle de l’événement et celle de son surgissement dans la mémoire de l’auteur et de son écriture : «1944-1965.» Le développement de ce récit autobiographique selon un déroulement non chronologique et les relations insolites qu’il tisse entre des événements historiques – qui auraient fait l’essentiel d’un livre de Mémoires – et la vie personnelle de l’auteur, expliquent dans une large mesure le choix du titre Antimémoires : «J’appelle ce livre Antimémoires, parce qu’il répond à une question que les Mémoires ne posent pas, et ne répond pas à celles qu’ils posent, et aussi par ce qu’on y trouve, souvent liée au tragique, une présence irréfutable et glissante comme celle du chat qui passe dans l’ombre : celle du farfelu dont j’ai sans le savoir ressuscité le nom.»27 Mais l’ouvrage, s’il fait place à l’expérience personnelle de l’auteur dans le domaine de l’histoire ou de la création, ne peut cependant pas être tenu pour un récit autobiographique traditionnel, car d’emblée, l’auteur dans le prologue, a écarté de son propos toute référence à sa vie privée. Il ne sera pas question pour lui de revenir sur ce qu’il appelle le «le misérable petit tas de secrets»28 dont toute existence est tissée. Il fera l’impasse sur son enfance, sur sa famille et sur sa sexualité : «[…] que m’importe ce qui n’importe qu’à moi ? Presque tous les écrivains que je connais aiment leur enfance, je déteste la mienne»29 écrira-t-il. Et plus loin, pour signifier que l’écriture purement autobiographique avec cette complaisance que montre l’autobiographe à revenir sur ses expériences et ses émois les plus personnels : «Je ne m’intéresse guère »30 Le lecteur qui chercherait dans les Antimémoires la révélation d’un secret sur la vie de l’auteur – sa relation avec sa mère et ou son père par exemple – sera sûrement déçu. Rares y sont les références à la vie personnelle de l’auteur : de sa mère morte, par exemple, ne survivent dans son souvenir que les «lignes fines et profondes» 31de sa main. Il semble ainsi que Malraux se soit employé dans ce récit d’apparence autobiographique, à effacer, paradoxalement, tout qui a trait à sa vie personnelle. Les Antimémoires peuvent être ainsi considérés, sous cet angle, comme des anticonfessions. Mais la raréfaction du détail psycho-biographique y va de pair avec une incroyable considérable promotion du récit fictionnel : l’espace autobiographique est envahi par les grandes scènes de la création romanesque, comme «si la vraie vie, la vie réellement vécue» comme l’écrit Proust, n’était en fait que la «littérature».
Si l’auteur parle de sa vie avec mélancolie et désenchantement – «ma vie sanglante et vaine», dit-il, et s’il ne peut adhérer à aucun des rôles qu’il lui a été donné de jouer (celui de l’archéologue amateur, de l’aventurier, du militant, du chef d’un maquis et encore moins celui de Ministre), nous le voyons cependant faire un grand cas de ses écrits et s’y référer comme non seulement des jalons importants dans son parcours, mais aussi comme des symboles qui recèlent le sens même de sa vie. Ecrire sa vie dans les Antimémoires, reviendra alors pour l’auteur à tenter de retrouver, au fil du voyage qui le conduit en Chine, le contexte de la création de ses romans asiatiques et à s’interroger sur le sens prémonitoire ou symbolique de certains épisodes fictionnels qui s’étaient imposés à lui.
Malraux s’inscrit volontairement en faux contre le «pacte autobiographique» en choisissant d’insérer dans son autobiographie des séquences prélevées dans son œuvre romanesque, et qui sont présentées comme des épisodes réellement vécus : «En face de l’inconnu, certains de nos rêves n’ont pas moins de significations que nos souvenirs. Je reprends donc ici de telles scènes autrefois transformées en fiction. Souvent liés au souvenir par des liens enchevêtres, il advient qu’elles le soient de façon plus troublante, à l’avenir.»32 La parallèle qu’il établit avec Victor Hugo est destinée en effet à montrer combien la fiction peut préfigurer la réalité : «On ne m’a pas attendu pour savoir que Victor Hugo avait écrit Marion Delorme avant de rencontrer Juliette Drouet.»33 La vie serait chargée ainsi de dérouler la part de destin qu’elle recèle, et que l’écrivain a confiée d’abord, et à son insu, à la fiction romanesque.
2. Le jeu intratextuel : fiction et autofiction
La formule de Jorge Luis Borges dans la préface de ses Oeuvres complètes : «Ce livre est fait de livres»34 s’applique parfaitement aux Antimémoires qui se caractérise par la prolifération du jeu, non pas seulement intertextuel, mais aussi et surtout intratextuel : des pans entiers de l’oeuvre romanesque de l’auteur, appelés par le génie des lieux revisités, viennent prendre place, à peine, remaniés, dans son œuvre autobiographique. En effet, outre le fait que sur les cinq parties de l’ouvrage, quatre portent des titres de ses romans (Les Noyers de l’Altenburg, La Tentation de l’Occident, La Voie royale et La Condition humaine), on relève également que certains chapitres des Antimémoires notamment le chapitre I, sont formés presque entièrement de longs extraits empruntés à l’un des ces romans. Ces titres et ces emprunts ont pour effet de tirer le récit autobiographique vers la fiction, voire même vers l’autofiction comme nous tenterons de le montrer plus loin. On s’attendrait alors dans cette autobiographie qui se mire dans la fiction que l’auteur nous introduise dans les coulisses de sa création et nous explique comment il a procédé pour transformer le fait réel en fiction. Or, ce que l’auteur donne à lire le plus souvent comme «scènes autrefois transformées en fiction», ce sont ces scènes mêmes que donne à lire la fiction romanesque. La vie de l’auteur vient de se confondre avec les scènes extraites de Temps du mépris (1934), de La Voie royale (1930), de La Condition humaine (1933), des Noyers de l’Altenburg (1943) ou du roman posthume, Le Règne du Malin, (1996). Le schème fictionnel est si puissant que sa source réelle s’abolit, et qu’il fait office de réalité. Quand Malraux parle de la «réalité des scènes», il se réfère en fait moins à l’expérience vécue, qu’à sa transfiguration par l’imagination et par l’écriture. Les souvenirs entrent alors dans l’oeuvre autobiographique non sous la forme de faits avérés, nettement distincts de leur transfiguration romanesque, mais sous la forme même qu’ils ont reçue dans cette fiction, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur «véracité» auprès du lecteur qui est conduit à confondre la fiction romanesque avec la «vérité» autobiographique. Loin d’être involontaire, cette confusion est le produit de la stratégie énonciative même dans la mesure le mémorialiste a gardé le même système d’énonciation, à l’occasion de l’insertion des longs extraits romanesques dans le texte autobiographique. L’emploi dans le texte cité et du texte citant du pronom de la première personne favorise la fusion des textes fictionnels dans le discours du mémorialiste. Ce qui montre encore que l’auteur n’a pas cherché à adapter le fictionnel à l’autobiographique, la fiction à la diction comme aurait Gérard Genette, c’est que les extraits cités ne sont pas, non plus, suffisamment démarqués du texte proprement autobiographique par une présentation typographique particulière. En effet, l’un des principaux traits de l’écriture autobiographique malrucienne dans les Antimémoires est l’insertion dans le texte proprement autobiographique de longs fragments appartenant aux différentes œuvres romanesques de l’auteur. Il conviendrait de s’arrêter sur les principaux épisodes fictionnels pour étudier comment ils s’intègrent dans le discours autobiographique et quelles «confusions» ils entraînent : Le premier fragment rapporte un épisode des Noyers de l’Altenburg, qui se déroule en Alsace. Il s’agit d’un un récit à la première personne qui relate le suicide de Dietrich Berger, oncle du narrateur et qui est présenté aussi comme l’ami de Friedrich Nietzsche. Par le biais du premier extrait, le mémorialiste se crée son roman familial et se dote d’une ascendance alsacienne, lui qui descend d’une famille de petits artisans de Dunkerque. «Et n’est-ce pas le comble de la fiction que de substituer à une généalogie flamande d’artisans une dynastie alsacienne de grands intellectuels.»35 C’est que le mémorialiste se croit prédestiné à avoir avec l’Alsace un rapport privilégié : «J’avais été cinq ou six semaines hussard, à Strasbourg […], les personnages s’appellent Berger parce que ce nom est selon sa prononciation, français ou germanique. Mais il est devenu le mien deux ans durant […]. Et j’ai été appelé par les Alsaciens à commander la brigade Alsace-Lorraine, et j’ai livré les combats de Dannemarie après la mort de ma seconde femme dans une clinique de l’avenue Alsace Loraine à Brive.»36 Quand il lit à la première ligne «mon père», le lecteur est bien en peine de comprendre qu’il ne s’agit pas du père de Malraux, mais celui du fictif Berger. Cette généalogie de grands intellectuels alsaciens dont le narrateur feint de se croire l’héritier, c’est le rêve touchant du jeune Malraux d’être né par autogenèse de Nietzsche et de Dostoïevski, de Gide et de Valéry, de T. E Lawrence et de Frobénius. Sartre s’exaspérait d’être né de la même dynastie que le docteur Schweitzer ; Malraux a rêvé d’une famille de philosophes, d’organistes et de théologiens. Il a grâce à cette insertion de ce fragment qui se rapporte à la famille du héros des Noyers de l’Altenburg, effacé son enfance banlieusarde et s’est doté d’un autre «roman familial» plus prestigieux. Malraux écrit avec l’oubli. L’autofiction vient combler les silences de l’autobiographe sur une enfance détestée, une famille éclatée et tant de drames cruels dont la mort accidentelle de sa compagne Josette et des deux fils. Les Antimémoires est un récit oblique, un miroir, non pas brisé, mais reconstitué, recomposé.
La deuxième «réimplantation» des Noyers est la plus hardie et la plus «trompeuse» selon certains critiques : Elle concerne le combat des chars livré par le narrateur et ses compagnons en 1940. L’épisode détaché de l’ensemble du texte, est placé sous la date de 1940. Il relate une offensive des blindés français, en Flandre. Il est précédé de cette brève présentation qui en souligne le caractère «historique» : «Je rentrai dans le bungalow désert du dernier gouverneur de Bombay, pour y relire ce que j’écrivais en 1940 de mes camarades qui se battaient et mouraient en vain…»37 Puis le récit s’enclenche ainsi : «1940. / Une route toujours la même, et les pierres de Flandres toujours aussi dures sous les chenilles de nos chars.» L’adjectif possessif «nos chars» et le pronom «nous» dans «Dernière nous, neuf mois de casernes et de cantonnements », «Nos chars roulaient vers les lignes allemandes. Nous étions quatre dans le nôtre »38 impliquent le narrateur dans cette aventure. Le tank tombe dans une fosse anti-char et parvient à en sortir en faisant machine arrière. Après avoir échappé au danger, les quatre soldats entent dans un village évacué par les Allemands. C’est à la fin de cette expérience que le narrateur prononce comme un hymne à le vie humble et que le «je» du narrateur dans la séquence de la fosse à char citée rejoint, d’une manière inattendue, celui du mémorialiste.
«Pourquoi ce matin de 1940, avec ses dahlias écrasés par les chars ? / C’était un retour sur la terre, comme celui que j’avais connu après la lutte de l’avion de Saba »39. L’auteur fait allusion à la fameuse expédition aérienne qu’il avait organisée en 1934 pour retrouver Mareb, la capitale de la Reine de Saba, et au cours de laquelle son avion a été pris dans un ouragan. Un épisode fictionnel est mis ainsi sur le même plan qu’un épisode réel et revendiqué par un même «je», en qui se confondent le narrateur intradiégétique des Noyers de l’Altenburg et le narrateur homodiégétique des Antimémoires. Et peu plus loin, le mémorialiste s’approprie totalement l’aventure de son héros : «Selon la chanson de Maura, la brave dieu-éléphant Ganesha “reviendra se promener sur son rat, et la lune rira à travers les nuages”, comme sur mon avion en Espagne, sur mon char en 1940 […].»40 En effet, nous voyons qu’au moment de raccorder la séquence fictionnelle empruntée au final des Noyers de l’Altenburg à son voyage en Inde, le mémorialiste présente cet épisode fictif comme un fait historique, quand il remarque qu’il s’agit là du seul combat auquel il ait participé avec des soldats mobilisés. La frontière entre la rêverie héroïque et l’expérience effective du combat s’estompe complètement. Comme si le vaincu de 1940 cherchait à nier sa défaite en développant une fable exaltante. Le lecteur averti appréciera d’autant plus cette démarche pathétique qu’il sait que l’auteur n’a jamais caché que la division de chars dans laquelle il s’était engagé en 1940 comme soldat de 2e classe, n’a jamais participé à la moindre campagne : «Ma guerre de quarante ? Dérisoire…Nos chars de Provins étaient hors d’état de nous porter hors du polygone d’entraînement. En mai, nous avons fait mouvement à pied, avec des antichars. Nous avons un peu tiraillé. J’ai été très légèrement blessé le 15 juin. Et le 16, nous étions faits prisonniers comme des fantassins, à mi-distance, à peu près de Provins et de Sens […].»41 Le péritexte pointe les faits réels alors que le texte autobiographique invente un scénario qui répond au désir secret du héros qui se laisse aller à un rêve héroïque par lequel il répond d’une part à la défaite de son pays et d’autre part, au désir secret de marcher sur les traces de son père qui été capitaine dans les blindés en 1918. Cette marche imaginaire contre l’ennemi en 1940 que le mémorialiste appelle de tous ses vœux, se trouvera authentifiée en 1944-45 quand le mémorialiste sous le nom du colonel Berger, mène à la victoire les blindés de la Brigade Alsace-Lorraine. Le mémorialiste de 1967 s’arroge ainsi le droit de reprendre la fable située en 1940, pour décrire obliquement la campagne militaire de 1944-45. La fiction de la victoire préfigurait ainsi une victoire vraie. Dans les Antimémoires, l’épisode de 1940, qui est une pure fiction prend, métonymiquement, la place du récit vrai de la campagne de 1944, que Malraux ne contera pas.
Le troisième épisode concerne la rencontre d’André Malraux avec l’un de ses personnages les originaux, le baron de Clappique qui apparaît dans la condition humaine. Personnage secondaire dans ce roman d’action qui raconte l’insurrection communiste en Chine et sa répression par l’armée nationaliste, il y apparaît comme un aristocrate déchu, courtier en objets d’art, vivant d’expédients, fréquentant assidûment les boîtes de nuit, les prostituées les maisons de jeu, et racontant à qui veut l’entendre des histoires extravagantes. A la fin de La Condition humaine, Clappique plein de remords de n’avoir pas transmis à Kyo les renseignements qui auraient pu le sauver – a été retenu dans une maison de jeu – et craignant la répression qui s’est abattue sur Shanghai, il réussit, déguisé en marin, à s’embarquer pour la France. C’est sans doute parce qu’il a pu échapper à cette répression dont Kyo, Katow et tant d’autres militants communistes ont été les victimes, qu’il peut faire son retour dans une autre œuvre de l’auteur. Mais à la différence des personnages de Balzac qui passent d’un roman à l’autre, le caractère incongru du retour de Clappique est qu’il surgit dans un écrit autobiographique comme une personne réelle.
En effet, dans les Antimémoires, le farfelu baron de Clappique, et qui est identifi par le lecteur comme un personnage de roman, se mêle à des personnes réellement rencontrées par Malraux à Singapour, en 1965, comme le consul général de Singapour et son épouse, l’ambassadeur de France, et l’inspecteur des Consulats qui occupa le poste de Giraudoux. Il lui fait même tenir le devant de la scène. «Arrive un personnage que je reconnais avant qu’on l’ait annoncé, bien que je ne l’aie pas vu depuis trente ans : c’est le baron de Clappique. Il n’a plus de taffetas sur l’œil, mais un monocle. Malgré la calvitie, son profil de sympathique furet n’a pas changé. Jadis, il se fût précipité, les bras en aile de moulin : «Vous ici ! Pas un mot ! rentrez sous terre !» L’âge l’a calmé.»42 Ses tics, ses mots d’esprit, son goût du coq-à-l’âne «inspirent au consul et à sa femme la sympathie bienveillante qu’il inspirait jadis.»43 Clappique regrette l’extinction de la race des aventuriers et prononce sur Rimbaud trafiquant en Abyssinie, un jugement sans appel : «Rimbaud, dit Clappique : haffreux. Rentrez sous terre. Quarante mille francs dans sa ceinture ! Revient pour se
marier ! D’abord un aventurier est célibataire ! Ensuite, il n’économise pas des sous pour rentrer ne Europe. Un aventurier intéressé, c’est un fol.»44
Certains critiques comme Frédéric Grover, ont vu, avec raison dans ce retour de Clappique comme «l’une des réussites les plus étourdissantes des Antimémoires» dans la mesure il assure un nouveau départ pour cette veine farfelue qui s’était épanouie dans les premiers écrits de l’auteur comme Lunes en papier (1921) et Royaume- Farfelu(1928).
Cette «réapparition balzacienne» occupe une place de choix dans l’œuvre autobiographique où elle s’étend sur tout le chapitre intitulé La Voie royale qui compte une centaine de pages dans la collection blanche (p. 375-473).
Après le départ des personnalités officielles, Malraux retrouve au bar de l’hôtel «Raffles», le baron de Clappique accompagné de son chat «Essuie-Plume», avec qui il a une longue conversation au sujet d’un projet de film : «Donc, nous avons fait, Essuie- Plume et moi, un p’petit chef-d’oeuvre sur lequel j’aimerais avoir votre avis. Ça s’appelle Le Règne du Malin. Il n’est pire raseur que les littérateurs, mais vous verrez.»45 Clappique semble être un fin connaisseur de l’œuvre romanesque de Malraux car il lui explique : «Je serais heureux de causer avec vous, un peu à cause d’autrefois, mais surtout parce que je suis entrain de préparer un p’petit film sur un type auquel vous vous êtes intéressé au temps de la Voie royale : David de Mayrena, le roi des Sedangs. J’ai trouvé pas mal de documents de derrière les hibiscus qui vous intéresseront.»46
Malraux parle ainsi avec Clappique, un personnage de fiction, d’un aventurier français réel dont il s’était s’est inspiré pour créer le héros de son roman la Voie Royale, Perken : «Je n’ai pas oublié Mayrena, écrit le mémorialiste dont la légende, encore présente en Indochine des années 20, est en partie à l’origine de ma Voie royale. Encore ne m’a-t-elle donné qu’un décor. Perken était l’incarnation dans un type de hors-la-loi encore répandu lorsque j’écrivais mon livre, du héros négatif. Sa marche contre les Stiengs, son défi délibéré à la torture doivent tout à l’idée qu’il se fait de lui-même, à la plus terrible lutte contre la mort.»47 Clappique qui n’est pas d’accord avec l’idée que Malraux se fait de David de Mayrena («Rentrez-sous terre ! Essuie-Plume, voilà ce que croient les ministres ! Passons… Ca ne s’est pas tout à fait passé comme ça. Ca ne s’est même pas passé comme ça du tout !»), se met à lire en le jouant un peu le scénario du film intitulé Le Règne du Malin. Malraux se contente alors de donner la réplique à Clappique, devenuen la circonstance mime ou acteur: «Clappique possède toujours le surprenant don d’imitation qui m’éblouissait autrefois. Il lit sans indiquer les personnages. Pour Mayrena, il a mis au point un ton aussi singulier que le sien, le ton des derniers romantiques. […]. Il lit les indications scéniques d’une voix neutre.»48 Mais qu’est-ce que ce projet de scénario sinon la réécriture cinématographique par Malraux d’un roman inachevé qui s’appelle justement Le Règne du Malin. Dans la notice de ce roman publié en Pléiade en 1996, Jean-Claude Larrat explique en effet que le Règne du Malin «a été bien écrit en comme un roman », et que sa transformation en scénario – scénario imaginaire – n’apparaît pas avant les Antimémoires».49 Comparé aux fragments de synopsis publiés par Denis Marion 50 et assumés directement par Malraux, le scénario fictif attribué à Clappique retient l’attention par une action riche en rebondissements, des situations extravagantes et par une plus grande exubérance stylistique. S’il choisit de faire raconter son Règne du Malin par un personnage de roman particulièrement par son goût de l’affabulation et de la fiction, c’est à la fois pour ressusciter et exalter le monde de la légende héroïque que Mayrena a pu incarner aux yeux du jeune homme qu’il a été en 1928, à l’époque de l’écriture de la Voie royale –[…] en 1965, je pense au-dessus du Pacifique, au jeune homme de 1928 » 51 – et pour en souligner la permanence en l’opposant à l’histoire qu’il avait, à tort, investie d’une fonction métaphysique et qui s’avère n’être que le «rêve d’un fou» car «la torture y a pris un accent terriblement banal.» La faillite de l’histoire favorise ainsi le retour du farfelu qui est le l’art de vivre intensément dans la fiction. Et c’est d’ailleurs à propos de Clappique que Malraux a cette formule souvent citée par les théoriciens de l’autofiction : «Ce n’était ni vrai, ni faux, mais vécu » 52, formule que l’on peut appliquer à toutes ces séquences fictionnelles insérées dans le récit autobiographique.
Cette transgression des règles de l’autobiographique dans un texte qui juxtapose le fictionnel et le non-fictionnel a choqué plus d’un critique.53 En fait, cette pratique de l’écriture autobiographique procède en fait d’une conception plus complexe du «moi».
Dans son étude : «D’une jeunesse européenne», Malraux avait évoque le «moi» dans les termes les plus équivoques : «Le Moi, palais de silence où chacun pénètre seul, recèle toutes les pierreries de nos provisoires démences mêlées à celles de la lucidité ; et la conscience que nous avons de nous –même est surtout tissés de vains désirs, d’espoirs et de rêves.»54 Le «moi» n’est donc pas, pour Malraux, une instance consciente aux contours bien définis, mais bien un tissu de songes, une entité complexe où l’existence rêvée et l’existence vécue sont intimement liées et se nourrissent l’une de l’autre 55. C’est la part d’imaginaire qui sous-tend la vie profonde du moi que révèle cette écriture autobiographique qui trouve dans la fiction romanesque son meilleur alliée, en donnant à lire un récit autofictionnel où la contradiction, loin d’être une tare, est au contraire est un principe constitutif : «le pacte autofictionnel se doit d’être contradictoire»56, écrit avec raison Jacques Lecarme.
Avec les Antimémoires, il aura tenté de renouveler sensiblement, et en toute lucidité, l’art de l’autobiographie en l’émancipant du récit factuel pour y intégrer les rêves et les fictions que l’homme se fabrique ou qui naissent dans son imaginaire, pour répondre à la maldonne de la naissance, à la folie de l’histoire et à la tragédie de la mort.
Par l’autofiction, il aura tenté de surmonter l’épreuve du désespoir et du doute. Il a trouvé, dans le jeu de la réécriture et de le réappropriation de ses propres fictions le moyen de donner un sens à ce qu’il a appelé dans les Antimémoires sa «vie sanglante et vaine».
N’est-ce pas hautement significatif que lorsqu’il a été confronté en 1972 à la cruelle épreuve de la maladie, il n’ait pas trouvé mieux pour exorciser le fantôme de la mort, que d’invoquer non pas le Seigneur ou la Vierge Marie, mais les scènes de la fraternité qu’il a exaltées dans son œuvre romanesque, notamment la scène du préau dans la Condition humaine ou la scène de l’attaque sur la Vistule des Noyers de l’Altenburg ? Par la fiction, et plus particulièrement l’autofiction riche de ces images emblématiques, non pas données par la vie, mais créées par l’artiste, il s’emploie à exorciser le démon du désespoir, à réécrire l’histoire pour transformer la défaite en victoire, et à repousser les frontières du réel pour en faire triompher les puissances de l’imaginaire. Loin d’être dissimulé au regard du lecteur, ce processus de reconstruction de soi par la fiction, est bien mis en évidence par un dispositif paratextuel que l’auteur a contribué à mettre en place : Les biographies de l’auteur, ses déclarations, les témoignages de ses contemporains sont là souligner ce qui est d’ordre biographique et ce qui ne l’est pas – la chronologie de l’édition Pléiade remplit pleinement cette fonction. La lecture de la dimension autofictionnelle de son récit autobiographique est conditionnée par la prise en compte de la trame biographique réelle, sans quoi, le fictif se fondrait dans le biographique et perdrait toute pertinence et toute signification particulière : il serait pris alors soit pour de la fiction, soit pour un récit autobiographique. Contrairement à Mounir Laouyen qui estime que le dispositif autofictionnel ne peut fonctionner qu’en l’absence d’informations autobiographiques ou biographiques, nous pensons que le récit autofictionnel ne peut se déployer véritablement qu’en connaissance de cause, c’est-à-dire comme un écart par rapport à une trame dont les fils sont bien connus du lecteur. C’est son statut de catégorie intermédiaire, hybride qui donne à l’autofiction son identité spécifique. C’est pour cela que Malraux n’a pas caché son jeu dans les Antimémoires, et qu’il s’est attaché à donner à voir le processus complexe qui le conduit à s’approprier la famille et la geste héroïque des ses personnages, ou à traiter le plus fameux d’entre eux comme une personne qu’il retrouve après plus de trente ans et qui lui parle de son propre récit abandonné depuis 1943. Seul un lecteur peu familier avec l’oeuvre romanesque de Malraux et de son univers imaginaire, et prenant les Antimémoires pour une autobiographie traditionnelle, crierait à la mystification et dirait que Malraux n’a fait ni la campagne de Flandre ni rencontré le baron de Clappique et l’accuserait de mythomanie. Mais le lecteur averti sait que le «je» qui s’exprime dans les Antimémoires est le moi mythique de l’auteur, tourné entièrement vers la création d’une légende, une légende semblable à celle qu’évoque Baudelaire dans Petits poèmes en prose: «Peut être me direz-vous : “Es-tu sûr que cette légende soit vraie ?” Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis.»
Notes :
1 «Autobiographie ? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de leur vie, et dans un beau style. Fiction, d’événements et de faits strictement réels ; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. Rencontres, fils des mots, allitérations, assonances, dissonances, écriture d’avant ou après la littérature, concrète, comme on dit musique. Ou encore, autofiction, patiemment onaniste, qui espère maintenant partager son plaisir.» Serge Doubrovsky, Fils, Paris, Galilée, 1977. Quatrième de couverture.
2 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, coll. «Points», 1996, p. 41-43.
3 Jacques Lecarme, «Malraux : l’autobiographie en procès», L’Ecole des Lettres, n° 6, 2001-2002,
p.45.
4 Cf. Henri Godard, «La question des faits dans Le Miroir des limbes», L’Ecole des Lettres, n° 6, 2001,
p. 49.
5 Edson Rosa da Silva, «Autobiographie/Antibiographie», Revue André Malraux Review, volume 26,
numbers 1-2, 1996-1997, p. 107-127.
6 Voir Michel Braudeau, «Avec André Gide sur la pas de la porte», in Le roman français contemporain,
Minstère des affaires étrangères, ADPF, juin 2002, p. 22.
7 Jacques Lecarme, «Malraux et l’autobiographie», La Revue des Lettres modernes, n° 9, Minard, 1995,
p. 45.
8 Olivier Todd, André Malraux, une vie, Gallimard, 2001.
9 Ibid., p. 493-494.
10 Henri Godard, «La question des faits dans Le Miroir des limbes», L’Ecole des Lettres, n° 6, 2001, p.
49.
11 Mounir Laouyen, Université Blaise Pascal, «L’autofiction : une réception problématique», site
<www.fabula.org>.
12 Vincent Colonna, L’Autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature, thèse inédite,
dirigée par Gérard Genette, EHESS, 1989, p. 46.
13 Antimémoires, Oeuvres complètes, t. III, La Pléiade, 1996, p. 160.
14 Voir la chronologie de la vie de l’auteur établie par François Trécourt dans les Oeuvres complètes, t.
II, La Pléiade, 1996, p. LXII-LXIII.
15 Antimémoires I, Le Miroir des limbes, Oeuvres complètes, t. III, La Pléiade, 1996, p. 184.
16 Ibid. p. 184-185.
17 Ibid., p. 185.
18 Ibid., p. 5.
19 Ibid., p. 7.
20 Ibid., p. 280.
21 Ibid., p. 7.
22 Idem.
23 Ibid., p. 61.
24 Ibid., p. 72.
25 Ibid., p. 10.
26 Ibid., p. 159.
27 Ibid., p. 16.
28 Ibid., p. 10.
29 Ibid., p. 6.
30 Idem.
31 Ibid., p. 71.
32 P. 13.
33 Antimémoires, op.cit., p. 13.
34 Jorge Luis Borges, Préface, Oeuvres complètes, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard, p. X.
35 Jacques Lecarme, «Malraux et l’autobiographie», in Notre siècle au Miroir des limbes, La Revue des
Lettres Modernes, n° 9, Minard, p. 42.
36 Antimémoires, op.cit, p. 13.
37 Ibid., p. 242.
38 Ibid., p. 320.
39 Idem.
40 Idem
41 Jean Lacouture, André Malraux, Une vie dans le siècle, Seuil, 1973, p. 271.
42 Antimémoires, Gallimard, «Collection Blanche», 1967, p. 376.
43 Ibid., p. 377.
44 Ibid., p. 378.
45 Ibid., p. 380.
46 Ibid., p. 376.
47 Ibid., p. 380.
48 Ibid., p. 383.
49 Oeuvres complètes, t. III, p. 1304.
50 Denis Marion, Malraux et le cinéma, Seghers, p. 119-133.
51 Antimémoires, p. 473.
52 La Condition humaine, Oeuvres complètes, t.III, La Pléiade, 1989, p. 693.
53 Même Pierre-Henri Simon s’y est laissé prendre puisqu’il a reproché à l’auteur sur les colonnes du
Monde en 1967 de mélanger réel et imaginaire dans le but de tromper son lecteur, pour se faire passer pour un résistant de la première heure.
54 «D’une jeunesse européenne», Les Cahiers verts, n° 70, Grasset, 1927, p. 142.
55 R. Robin, «L’autofiction. Le sujet toujours en défaut : le moi au conditionnel» in Autofictions & Cie.
Recherches interdisciplinaires sur les textes modernes, (France), n° 6, p. 73 -86, 1993. Publications du Centre de recherches interdisciplinaires sur les textes modernes Université de Paris X.
56 Jacques Lecarme, «L’autofiction : un mauvais genre ?», in Autofictions & Cie (colloque de Nanterre, 1992, dir. Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme et Philippe Lejeune), RITM, n° 6, p. 242.